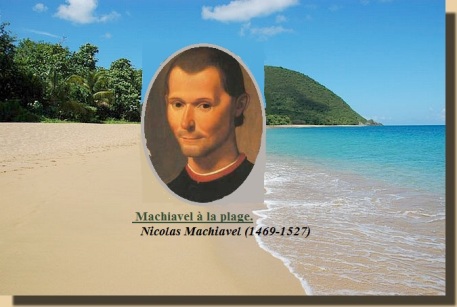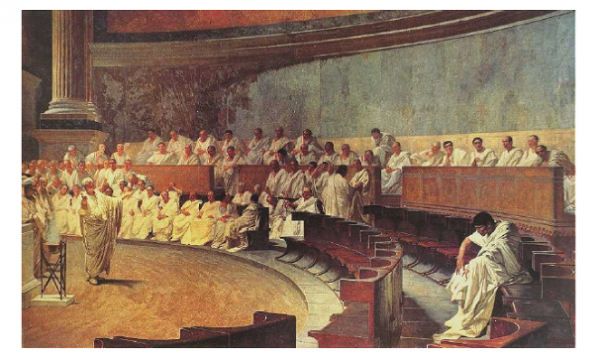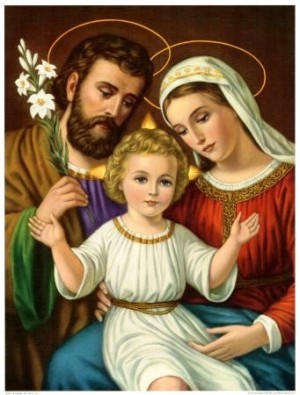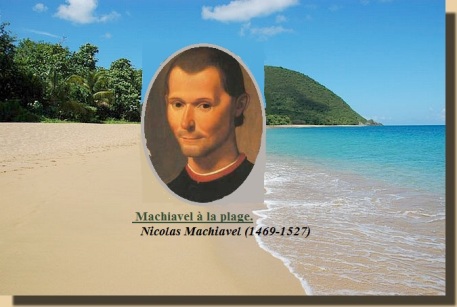
Machiavel à la plage (WLWB-2015).
Nicolas Machiavel (1469-1527) est un penseur politique qui, avant de se consacrer à l’écriture et l’examen politique de Florence, exerce dès 1498 des fonctions dans la seigneurie.
Au début du XVème siècle, Florence est gouvernée par les Médicis pendant la période du ‘Quattrocento’. Laurent de Médicis est à la tête de la République et voit ses pouvoirs accrus après avoir échappé à l’attentat de Pazzi en 1478 ; puis succède Pierre de Médicis, chassé au moment de l’arrivée de Charles VIII en Italie en 1494. Le roi de France autorisant alors les florentins à choisir leur propre mode de gouvernement, le dominicain Savonarole devient le nouveau dirigeant de la cité. Prédicateur à la parole ardente, ennemi des Médicis, il institue ce qu’il nomme la « République chrétienne et religieuse » et en est à la tête jusqu’à ce qu’il soit brûlé en 1498.
C’est ainsi qu’à 29 ans, Machiavel entre dans la seigneurie comme secrétaire de la seconde chancellerie de Florence. En 1498, l’Italie est factionnée en une multitude de républiques, de seigneuries et d’Etats plus ou moins importants qui se font la guerre et seront incapables d’opposer une résistance aux convoitises dans les Etats forts : l’Allemagne, l’Espagne, la France.
Le 23 mai 1498, Machiavel commence sa carrière de fonctionnaire de la seigneurie. Il se voit confier des responsabilités au Conseil des dix, chargé des affaires extérieurs et des questions militaires. Il rencontre alors plusieurs personnalités de la vie politique italienne.
En 1499, il est chargé de se rendre à Forli, chez la comtesse Catherine Sforza Rivero pour renouveler l’engagement militaire de son fils Ottaviano. A son retour, il est envoyé à Pise (en guerre avec Florence), qui veut rétablir sa domination sur Florence. Il assiste alors à la trahison des condottieri Paolo et VitellozzoVitelli, chargés de faire siège de la ville de Florence. Machiavel est également témoin de la rébellion de troupes franco-suissent que Louis XII a envoyé au secours de la République, son alliée. Les troupes arrêtent de se battre prétendument par manque d’approvisionnement. D’où sa première légation en France en 1500 aux côtés de Francesco Della Casa.
Machiavel se voit confier plusieurs missions jusqu’à ce qu’en 1510, il retourne en France. Louis XII veut l’aide des troupes florentines pour défendre son allié, le duc de Ferrare que Jules II vient d’attaquer. La République est menacée en raison de son alliance avec la France contre la Sainte Ligue. Dans Florence, la politique de Soderini suscite des mécontentements chez les partisans des Medicis qui veulent s’allier avec le pape contre la France.
En 1512, les espagnoles pénètrent en Toscane, prennent d’assaut Prato et les Médicis reviennent au pouvoir. Machiavel est révoqué. On l’accuse de complot et le condamne à la prison. Il est finalement relâché par amnistie de Jean de Médicis (Léon X) au pontificat.
Il est finalement condamné à l’exil. Il commence son travail d’écrivain. Il travaille sur les Discours sur la première décade de Tite-Live, qu’il interrompt en 1513 pour écrire Le Prince dédié à Laurent II de Médicis, et il reprend son écriture en 1519. Les Discours sont imprimés en 1532, après sa mort.
Dans cet ouvrage, Machiavel ne donne pas seulement des techniques de conservation du pouvoir, mais il s’interroge sur son origine, la nature de la société et la liberté politique.
Il met ainsi en évidence la division sociale comme fait premier et irréductible. L’antagonisme des désirs de classe, des Grands et du peuple, soit celui entre les désirs de commander et d’opprimer, et celui de ne pas l’être sont fondateurs pour l’auteur. Pour ce faire, Machiavel fait référence à la Rome antique pour éclairer la situation florentine, dont l’appréciation des premiers humanistes consistait à louer les vertus de concorde de la République romaine et de fonder les raisons de sa décadence sur l’indiscipline du peuple. Machiavel prend le contre-pied et met l’accent sur le conflit comme condition d’émergence de bonnes lois (I). La confrontation entre le Sénat et la plèbe est caractéristique d’un espace politique au sein duquel le peuple peut librement exprimer ses ‘humeurs’. A cet égard, la grille de lecture Machiavélienne conserve son actualité là où l’approche néolibérale annexe l’espace politique au domaine économique ; de même qu’elle ne réitère pas pour autant une vulgaire séparation la figure du Prince (ou de la Princesse …) et celle de l’homme. Le Prince est tenu à une discipline que lui rappelle constamment le peuple. Un peuple qui se contente de vieux porcs accusés de proxénétisme et de viol en guise de « gouvernants », ne se transformera en rien d’autre qu’une bête de foire couillue irresponsable (II).
I) La République entre acte de fondation (virtù) et liberté politique.
Machiavel énonce un paradoxe qui constitue pourtant une condition du déploiement de la liberté des ‘petits’ et l’institution de bonnes lois. En effet, si la République s’oppose au « régime d’un seul », son instauration dépend d’un seul homme, lequel doit tenir en respect ses sujets, éliminer les oppositions pour imposer un ordre fondateur en rupture avec l’ancien. Mais cette ‘violence réparatrice’ garde pour fin le bien commun et le prince ne peut l’atteindre sans le concours du peuple, citoyen-guerrier, tenants de la liberté puisqu’en dissension irréductible avec les Grands et chargés de la maintenir pour protéger la République.
A) Les instances républicaines et l’émergence d’un « lieu vide » du pouvoir ,entre désirs des Grands et refus du peuple.
La fondation unilatérale de la République
Machiavel souligne que l’accaparement du pouvoir par un législateur n’est pas à condamner même s’il s’éloigne de normes communes pacificatrices. Puisque la violence qui répare n’est pas celle qui détruit par définition. Néanmoins, ce n’est pas à dire que la stabilité de l’Etat est à remettre entre les mains d’un seul homme. Au contraire, à la manière de Romulus qui défia ses frères et utilisa la violence non pour ses ambitions personnelles, mais pour le bien commun, il mit en place le Sénat sans cesse en délibération.
De même, l’auteur ajoute un autre exemple, celui de l’expulsion des Tarquins, dynastie dominant Rome peu avant la République à la suite de quoi il n’y avait plus de désagrément entre le Sénat et le peuple. Même les nobles contrôlaient leurs manières et leur orgueil, sans plus attirer l’outrage des citoyens. Toutefois, une fois les Tarquins disparus et la crainte d’un potentiel retour avec eux, les nobles n’avaient plus de raison de faire preuve de vergogne. Sans contrainte, les nobles optèrent pour « la liberté de commettre le mal avec impunité » par laquelle confusion et désordre faisaient loi.
Aussi, après la tentative des nobles de mettre en place des institutions inspirant la crainte suivant le modèle des Tarquins, l’on mit en place les tribuns – intermédiaires entre le peuple et le Sénat, dont la mission consistait précisément à calmer les ardeurs des derniers. Aussi, le prince ne peut envisager de s’éloigner des normes communes que de manière momentanée. Sa « méchanceté » est temporaire. La pérennité de la République est en définitive assurée par le concours ou l’ « amitié » du peuple et des moyens dont il dispose de contribuer à la cité. La mise en place de l’élection permet ainsi la succession des meilleurs des dirigeants potentiels, de même que le mandat est limité et donc les gouvernants soumis à la vigilance du peuple (chapitre XXXIV).
C’est ainsi que l’auteur montre que l’esprit des institutions républicaines est précisément la liberté. La liberté à laquelle aspire le peuple contre la démesure des Grands et à l’origine des bonnes lois, elles-mêmes fondatrices de bonnes mœurs.
Le conflit, instigateur d’un ordre légal au fondement d’un Etat libre.
L’Empire romain a bien été l’ouvrage de la fortune et de la discipline. Mais la discipline n’est pas sans l’institution d’un ordre. La fortune est alors par conséquence. Il convient de préciser le propos, à savoir justement que ce bon ordre est le fait des querelles entre le Sénat et le peuple, conflit porteur de liberté en dernier ressort – et non par dépit. En effet, « Dans toute république, il y a deux partis : celui des grands et celui du peuple ; et toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de leur opposition »(chapitre IV).
Les bonnes lois font des Républiques vertueuses, et ces lois sont le fruit des agitations entre les Grands et le peuple. Aucun préjudice lors de ces affrontements n’a été causé au bien public, au contraire, ils ont été à l’avantage de la liberté.
Pour ce faire, chaque Etat libre doit fournir au peuple le moyen d’actualiser son mécontentement ou son ambition afin de faire plier le Sénat comme ce fut le cas à Rome. En effet, lorsque le peuple voulait obtenir une loi, il refusait de s’enrôler pour la guerre. Or, les désirs d’un peuple font rarement défaut à sa liberté puisqu’ils lui sont inspirés par l’oppression dont il est l’objet ou qu’il redoute. S’il venait à se tromper, le peuple est assez sensible à la vérité pour entendre la parole sage d’un homme de bien et se retirer.
L’auteur insiste : « il y a, dans le premier [les Grands], un grand désir de dominer, et dans le second [le peuple], le désir seulement de ne pas l’être ; par conséquent plus de volonté de vivre libre » (chapitre V). Pour justifier son propos, Machiavel donne l’exemple de Venise et Sparte, où l’on prétend que le pouvoir de la noblesse permet de sanctionner la compétence et le mérite de ceux qui s’investissent dans les affaires publiques. On ajoute par suite que cela dispense le peuple d’une autorité abusive.
Trancher entre les deux modèles revient alors à reconnaître que Rome vise à l’expansion, alors que la République de Sparte et de Venise, visent à la conservation. Toutefois, quels hommes sont les plus malintentionnés en République ? Il convient d’examiner le cas de Ménéius et Fulvius, tous deux plébéiens. Le premier a été nommé dictature, le second maître de la cavalrie pour des recherches concernant un complot de Capoue contre Rome, de même contre les ennemis internes visant à satisfaire des ambitions politiques.
La noblesse accuse alors le dictateur de mener une omerta contre elle, et répand ce bruit dans tout Rome – prétextant que le peuple n’est pas vertueux mais bien corrompu par la volonté de pouvoir puisque ne disposant de titre, et non la noblesse. Ménéius fait finalement convoqué une Assemblée du peuple, en dénonçant la calomnie dont il était l’objet. Ménéius a finalement été innocenté.
Par conséquent, force est de constater que, si la conservation ou l’acquisition sont deux passions potentiellement dévastatrices, les dégâts sont occasionnés le plus souvent par ceux qui ont peur de perdre que celui qui désire acquérir. Et d’ajouter : « enlever à Rome les semences de troubles, c’était aussi lui ravir les germes de sa puissance » (chapitre VI). Il s’agit ainsi de comprendre ce que Pocock nomme le ‘moment machiavélien’, à savoir que la transcendance ne dicte pas les lois, mais que ce sont les hommes qui en sont à l’origine. Le pouvoir est un « lieu vide » puisqu’institution issue du conflit permanent entre les Grands et les ‘petits’ (Claude Lefort). La loi à cet égard, libère plus qu’elle n’interdit, n’étant plus seulement imposition oligarchique mais sans cesse discutée par le peuple ‘suspicieux’.
La loi comme virtualisation des litiges et garante de procès équitable.
Machiavel donne l’exemple de la noblesse lorsqu’elle accuse arbitrairement le peuple d’usurpation de pouvoir par la désignation de Tribuns censés les défendre. A ce moment –là, Rome était dans une période de famine et envoya donc les Tribuns en Sicile pour récolter des grains. Alors, Coriolan, ennemi du peuple, conseilla au Sénat de profiter de l’occasion pour châtier le peuple en lui refusant la distribution des grains et le menaçant de la famine. Le peuple pris connaissance de la manœuvre, et était prêt à le mettre à mort sans hésiter si les Tribuns n’avaient pas organisé un procès. Aussi, « c’est à l’occasion de cet événement que nous observerons combien il est utile, important, dans une république, d’avoir des institutions qui fournissent à l’universalité des citoyens des moyens d’exhaler leur fureur contre d’autres citoyens. À défaut de ces moyens, autorisés par la loi, on en emploie d’illégitimes qui produisent, sans contredit, des effets bien plus funestes.» (Chapitre VII).
Il ne s’agit pas d’une oppression résultant d’une justice particulière, ou par recours à une force étrangère, mais le recours à une autorité légale qui ne menace pas la liberté au sein de l’Etat.
Toutefois, l’accusation ne doit pas laisser place à la calomnie. Capitolinus, jaloux de la gloire de Camille dans la bataille contre les Gaulois, décident de répandre des rumeurs pour ternir sa réputation. Il prétend alors que l’argent censé avoir été donné aux Gaulois pour s’en défaire ne l’a pas été, et qu’il en reste dont l’utilité publique est indéniable. Le peuple excité, le Sénat décide de faire comparaître Camille pour répondre de ses allégations. A ce moment-là, il ne fournit que des réponses évasives. Et précisément, la calomnie contrairement à l’accusation, est douteuse car elle « n’a besoin ni de témoins ni de confrontation ni de rien circonstancier, pour réussir et persuader » (chapitre VIII). Il est donc du devoir du législateur de légiférer dans le domaine de l’accusation (judiciaire) – puisque la calomnie ruine à l’ordre de l’Etat, elle met les hommes dans tous leurs états mais ne les ‘corrige pas’ : « Forcez ceux-ci à devenir accusateurs, et quand l’accusation se trouvera vraie, récompensez-la, ou du moins ne la punissez pas ; mais si elle est fausse, punissez-en l’auteur comme le fut Manlius ».
Les institutions républicaines permettent donc un arbitrage des conflits entre les Grands et le peuple, et entre ‘justiciables’ sans que la sûreté de l’Etat ne soit menacée, puisque la justice est rendue selon l’ordre légal à son fondement. Aussi, loin de constituer un pouvoir séparé, l’Etat pour accroître sa force et assurer sa pérennité, laisse non seulement le peuple concourir à l’administration des affaires publiques, mais aussi à la défense de la cité.
B) L’armée nationale de citoyens, protectrice des libertés républicaines et déterminante d’un Etat fort.
L’art de la guerre et l’affirmation d’un Etat fort.
Pour l’auteur, si Rome connait un tel succès, c’est parce que les chefs d’Etat se succédant sont aptes à faire la guerre. C’est ainsi que dans le cas contraire: « David fut sans contredit un homme très recommandable, et par son courage et par ses connaissances et par son jugement. Après avoir vaincu, dompté tous ses voisins, il laissa à son fils Salomon un royaume paisible, qu’il put conserver en y entretenant les arts de la paix et non de la guerre, en jouissant sans peine des talents et des travaux de son père ; mais il ne put le transmettre ainsi à Roboam son fils.Celui-ci n’avait ni la valeur de son aïeul, ni la fortune de son père ; aussi ce ne fut qu’avec peine qu’il resta héritier de la sixième partie de leurs États ». (Chapitre XIX).
De plus, cela témoigne d’une incapacité du prince à former lui-même les hommes à la guerre. Ainsi le montre Tullus, qui une fois sur le trône, n’avait aucun romain guerrier à portée. Mais il forma lui-même les citoyens à devenir d’excellents soldats, sans avoir recours à des soldats étrangers. Sous l’autorité d’un Etat fort et légitime, les citoyens concourent à l’expansion et la défense de la République sans qu’il y ait dépendance étrangère. L’Etat dispose d’une ‘armée propre’ et accroît par suite sa puissance militaire.
Mais la puissance de l’Etat n’est pas seulement assurée de manière ‘profane’. Elle peut aussi l’être au moyen de la religion, du moment que l’Etre Suprême est subordonné à l’Etat.
Religion et stabilité politique.
Machiavel n’entend pas réitérer une conception chrétienne de la République. Mais il soutient d’une part que le prince nouveau n’a pas à redouter la pluralité religieuse au sein de l’Etat du moment qu’il a su conquérir l’amitié du peuple (chapitre X), et qu’au passage, la religion permet de trancher des litiges que les hommes ne semblent pas pouvoir surmonter.
En effet, contre le Tribun Terentillus qui avait occasionné des mouvements par la promulgation de certaines lois, les patriciens utilisèrent contre lui des moyens religieux, des livres prophétiques prédisant la chute de Rome si les dissensions montaient à l’intérieur du territoire. Ils réussirent à faire plier les Tribuns qui, de peur de perdre leurs droits, convenaient avec le peuple qu’il obéirait au Consul. La religion a donc permis au Sénat de résoudre un conflit insurmontable sinon, avec les tribuns.
Par ailleurs ajoute Machiavel, Romulus en l’occurrence n’a pas eu besoin de Dieu pour mettre en place le Sénat et autres institutions civiles ; mais Numa, pour se défier de l’autorité d’une ville dont il s’agissait de faire admettre de nouveaux usages, se référer à la parole de Dieu. Ainsi, les citoyens se pliaient aux conseils de Numa bénéficiant d’une légitimité divine.
La religion a donc assuré la prospérité de Rome, puisque sa crédibilité était concomitante à l’Etre Suprême. Cela assure la pérennité de l’Etat même après la mort du Prince.
Au sein même de l’armée, l’auspice peut jouer également un rôle favorable sur le moral des troupes. Le consul Papirius dit alors à l’armée que les auspices sont favorables alors que les gardes des poulets sacrés affirment le contraire.
Il prétend ainsi au mensonge – par inadvertance, un soldat tue le garde-menteur, Papirius affirme qu’il s’agit d’un signe divin bienséant pour le combat. En revanche, en Sicile, Pulcher se comporte différemment. Il ne se contente pas d’interpréter les auspices met de leur faire dire vrai de force. Ainsi jette-t-il les poulets sacrés à la mer. Il est battu au combat et puni à Rome.
A cela, Machiavel étend la ‘force’ nécessaire à la sauvegarde de l’Etat à chaque citoyen, de sorte que chacun doit faire preuve de prudence pour ne pas mettre en danger tout une cité.
La force au service de l’intérêt public et contre l’orgueil.
« On a toujours regardé comme peu sage le parti de hasarder toute sa fortune à la fois sans mettre en jeu toutes ses forces ; ce qui se fait de diverses manières» (chapitre XXIII), déclare l’auteur. En effet, Tullus et Métius décident de confier le sort du pays et de l’armée à trois de ses membres qui, si l’un des deux peuples étaient vainqueurs, l’un serait souverain de l’autre. Métius et son peuple ont finalement fini sous la domination romaine.
De la même manière, il convient lors du combat de penser de manière stratégique : « C’est la même faute que commettent presque toujours ceux qui, lors d’invasion de leur pays par l’ennemi, se déterminent à se fortifier dans les lieux difficiles, et à en garder les passages. Ce parti sera presque toujours funeste, à moins que, dans l’un de ces lieux difficiles, vous ne puissiez placer toutes vos forces. Dans ce cas, il faut le suivre. Mais si le lieu est et trop rude et trop resserré pour les y loger toutes, le parti est alors mauvais. ».
La prudence et l’ingéniosité doivent conduire la cité, et la force doit être mise au service de l’intérêt public. Il convient dès lors d’examiner les enjeux et de ne pas risquer le sort de tout un peuple sur quelques-uns, car alors, le hasard risque de gouverner plutôt que la virtù du prince.
Machiavel met donc en évidence la réciprocité entre les gouvernants et les gouvernés. Si le conflit est fondateur d’un Etat libre, l’auteur ne dissocie pas pour autant l’art de gouverner nécessaire à la constitution de la République. L’art de gouverner étant concomitant à l’art de la guerre, dont les citoyens-guerriers exécutent la force pour maintenir les libertés républicaines.
II) La nécessaire responsabilité politique du peuple-citoyen.
Si Machiavel est particulièrement connu pour son œuvre Le Prince, disposant d’une figure claire et éminente du gouvernant, et donnant d’ailleurs l’impression d’un « mépris du peuple », il nous semble que Les Discours s’inscrivent dans la continuité, et plus encore, Le Prince ne peut guère se comprendre sans les Discours. Rien ne vaut des exemples pour en montrer la portée contemporaine. Voyons ce qu’il se passe du côté du peuple … et du côté des Grands !
A) L’individu-entrepreneur et la a remise en cause de la ‘division originaire du social’.
Claude Lefort met également en avant la ‘division originaire du social’ suivant la pensée de Machiavel. Or force est de constater que l’égalitarisme, soit l’égalité sociale au sein des sociétés modernes rendent peu explicites ces termes.
L’on se trouve davantage dans la situation décrite dans le Chapitre VI des Discours, concernant Venise puisqu’en outre d’une délégation du pouvoir politique, le peuple ne fait pas l’objet de carences du point de vue économique de manière homogène. Toutefois, puisque l’aspiration à devenir Grands et l’apparente interchangeabilité des conditions semblent être la norme, la société civile – non pas société politique puisque s’y manifeste seulement un entrechoque d’intérêts immédiats – reste le théâtre de revendications catégorielles caractéristiques de l’individu narcissique postmoderne. En effet, comme le souligne Cynthia Fleury dans Les pathologies de la démocratie (2005) : « les minorités tyranniques comme l’individu pervers‘captent’ le droit et font en sorte que le processus démocratique travaille à l’entérinement de leur désir. » .
Loin d’un souci de l’intérêt public, la société est morcelée sans projet politique, chacun prétendant à une légitimité de fait répondant à l’exigence d’inclusion démocratique. Or précisément, le pouvoir étant issue des divisions sociales, l’institution n’est pas inclusive mais discriminante de principes fondateur d’un espace commun. Un éclectisme somme tout consensuel, dont l’objet est de manifester une marginalité qui instaure une unilatéralité et une partialité des institutions qui sont alors invitées à ‘faire proche’.
D’où la critique formulée par Cornelius Castoriadis et systématisée dans Le monde morcelé (ed.2000), du moment où le pouvoir est conçu en surplomb, l’auto-institution de la société est contrariée par le politique, soit la clôture du sens, et nuit à la création politique qui, si elle trouve son actualisation dans le « pouvoir explicite », n’est pas pour autant figée puisque ce pouvoir est « participable ». Les citoyens ne sont donc pas gouvernables par une autorité extérieure, et les mœurs ne privatisent pas l’espace public. Le souci du Bien Public partagé par les citoyens et les dépositaires temporaires de l’autorité publique permet de faire valoir la rationalité propre du politique, par lequel le dissensus ne se confond pas en doléances ou pour reprendre l’expression de Machiavel, en « factions destructrices ».
B) La responsabilité du peuple dans le maintien de la République : l’intolérable patriarcalisme.
Qui aurait cru que le bon vieux « Mac » pourrait nous être de recours pour penser politiquement le féminisme ?
Partons d’une citation : « Et si les princes sont supérieurs aux peuples pour établir des lois, organiser des vies civiles, établir des constitutions et des institutions nouvelles ; les peuples sont tellement supérieurs pour maintenir les choses établies » (Discours, I, 58, p142).
Bien que les apparences s’y prêtent, si vous avez bien lu la première partie, Machiavel n’est pas en train de nous faire un éloge grossier d’un pouvoir unilatéral qui ne vaudrait que par nature aristocrate du Prince.
Pensons à Clisthène, Périclès, Démosthène, ces dirigeants ayant marqué l’histoire et le fondement de la démocratie athénienne, et dont les principes de constitution ont été repris par la Rome antique donnant ainsi naissance à la « République ».
Le « souci de soi » comme l’entendait les Grecs, que cela soit de la part des citoyens, mais également des gouvernants temporaires, ne reconnaît pas la disjonction entre « image publique » et comportement privé. Car précisément, ce que l’on appellerait aujourd’hui une « figure publique » ne serait qu’un personnage hypocrite, faible, simplement soucieux de communication publicitaire (certains appellent ça « politique ») davantage que garant de l’intérêt général.
La constance n’est qu’une mascarade si elle ne fait que s’énoncer, sans être pratiquée, ni incarnée. Machiavel est clair : le Prince n’est pas tenu d’être « lui-même ». Comme précisé dans le billet consacré aux « Seigneurs de la table ronde de la démocratie contemporaine », la politique n’est jamais une confirmation de soi. En particulier lorsque « soi » souscrit à des pratiques illégales. Le civisme est continu, non pas privé ou public. Que sont-ce des principes qui ne seraient transcrits en mœurs ? Le « Beau » de l’Institution informe la société qui en a elle-même le souci.
Seulement (à juste titre toutefois), Machiavel fait reposer la stabilité de l’Institution juste sur le corps politique de citoyens. Telle est la grandeur républicaine. Mais que se passe-t-il quand un peuple n’est pas capable de faire la distinction entre un déballage de type Merci pour ce moment et le procès pour viol et proxénétisme dont a fait l’objet DSK ? Que se passe-t-il quand les médias fomentent l’ignorance et l’inconséquence en présentant les faits comme relevant d’une « sexualité rude », de « libertinage » de « liberté sexuelle » ? Comment se fait-il que le témoignage des victimes dénonçant le viol qu’elles ont subi fasse l’objet d’une indifférence générale ou du moins, ne soit perçu que comme anecdotique ? Quel est donc ce quiétisme qui ne vise qu’à se donner bonne conscience ?
Ah la prostitution, une activité si magnifique. Être réduite à un éjaculatoire-automate, d’une rationalité strictement calculante, l’intégrité du corps inviolable selon notre droit, vaudrait ici le prix d’une passe. Ah ces bons hommes qui pleurnichent et se servent comme des nantis des femmes sans que personne ne trouve rien à redire. Les pires bassesses intellectuelles (oulala, libre choix, nananère), les grossièretés et la vulgarité se trouvent concentrées en ce problème : après tout que des femmes soient sacrifiées et servent de sous-m****, ce n’est pas notre problème ? Et ces proxénètes qui ne font que répondre à la demande, mais tout va bien ! C’est normal que des femmes soient à vendre, surtout pour les riches qui achètent la justice. Ni vu ni connu, ainsi le peuple ne voudrait que la justice disait Machiavel ? Certains suggèrent pourtant que des hommes niant dans leurs actes les principes au fondement de notre République devraient avoir une voix dans le débat public. Cela n’est qu’une porte grande ouverte à la démagogie et l’entrisme. La « repentance délibérative », un petit reste chrétien- heureusement, le peuple n’est pas Dieu.
Pourtant, il semblerait que l’on attende de la société civile qu’elle joue en ce cas le rôle de confessionnal : Je viole, je prostitue, je passe à travers l’émail du filet, je n’ai aucune décence: ma carrière vaut mieux que la discrétion requise en ces situations induisant confusion (mais dans nos sociétés, le peuple n’est pas confus, il becte, ouf !), retrouvez mon nouvel article sur slideshare, (gentiment relayé par les quotidiens) pour déballer ce que tout le monde sait déjà sur l’austérité.
A part cela, veuillez me pardonnez, je ne suis qu’un homme. Les médias aidant, on tablera sur le sensationnalisme et la société n’aura qu’à pardonner du haut de sa très grande compassion … après tout, nous ne parlons que de l’honneur et de la dignité des citoyennes !
On pourrait souscrire à ce qui n’est pas totalement faux, soit suggérer que nous vivons dans une société patriarcale, mais vous conviendrez que ce constat ne sert pas à grand-chose. On le sait, agissons.
Prenons un autre exemple. Personne n’aura manqué le très bon goût du PS dans le choix de son secrétaire national. Yacine Chaouat condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violence aggravée à l’encontre de sa compagne- notons le prétexte évidemment abjecte, celle-ci aurait eu un comportement de « française » exacerbé – a été levé de ses fonctions ; cette fois, grâce à la mobilisation de citoyennes, féministes et citoyens sur les réseaux sociaux ayant montré le scandale d’une telle nomination.
Plutôt que de souscrire au sentimentalisme du PS, les actrices et acteurs de la société civile n’ont pas été dupes : comment pourrait-on prétendre œuvrer en faveur de l’intégration républicaine, et tolérer qu’un secrétaire national tabasse sa compagne et d’une, et de deux, sous prétexte qu’elle ne serait pas une propriété tribale authentique ?
Qu’à cela ne tienne, certains n’hésitent pas à comparer la responsabilité et la tenue des agents administratifs à un impératif économique : il a été condamné, il a payé sa dette à la société (six mois avec sursis, ça c’est une dette bien payée, dites donc), tout est effacé ! Que vous parliez du cas Chaouat ou de la dette grecque, aucune différence, vous êtes prévenu-es !
Or, le temps politique et juridique sont distincts et n’ont rien à voir. La culpabilité juridique est bien à titre individuel, mais la publicité du cas renvoie au fondement et la stabilité de la Cité. Quel message serait envoyé dans le cas contraire ? Allez-y, citoyens mâles, tabassez « vos » femmes, vous aurez une peine de six mois, et vous pourrez trouver un job au PS, lequel est assez lâche pour sortir la carte culturelle relativiste : « Tout bénef » comme disait l’autre. Par contre, la victime et ses séquelles, à la marge – on s’en fiche, c’est la femme invisible.
Bien entendu, le droit lui-même n’est jamais étranger à l’intention politique de la loi. A force de présenter les féminicides comme des faits divers, des cas ponctuels, la tentation comptable libérale : « Il y a des lois, la vie est belle, basta ! » – est un réflexe. Je vous renvoie, à cet égard, pour plus de détails à l’interview réalisée en 2013 auprès de l’anthropologue Christine Gamita concernant la reconnaissance en droit des féminicides : https://beyourownwomon.wordpress.com/2013/08/09/contre-limpunite-des-feminicides-2/
Par ailleurs, historiquement, du point de vue institutionnel mais également des idées, la violence est exclue dans la tradition démocratique entre citoyens égaux. A titre d’exemple, l’aéropage athénienne devant juger les crimes de sang notamment, se trouvait à l’écart de la Cité.
La violence exercée par un politès à l’égard d’un autre est jugée sévèrement, et se trouve être une honte socialement condamnée.
Comment pourrait-on croire que la responsabilité politique s’épuise dans la culpabilité juridique en cas de violence particulièrement ? Aucun prétendant à des fonctions politiques ne peut sérieusement, moralement, et honnêtement se présenter en ce cas publiquement. Cela n’est que cynisme. En République, la confiance à l’Institution, et, comme suggéré par Machiavel, sa pérennité qualitative prime des considérations compassionnelles envers celui qui prétend en être temporairement le dépositaire.
Finalement, la pensée machiavélienne est bien loin, comme vous pouvez le constater, du dévoiement commun suggérant que le « machiavélisme » justifierait n’importe quelle corruption. Si Machiavel affirmait que le Prince devait employer tous les moyens en vue de la réalisation d’une fin- soit, que la « fin justifie les moyens »-, cela ne peut se comprendre arbitrairement. C’est un contresens. L’auteur faisait état de l’indispensable émancipation du pouvoir politique à l’égard du pouvoir religieux ; mais le Prince, fort de sa vertu, devait faire preuve de suffisamment d’ingéniosité, sans prendre de risques inutiles, pour faire face à la « fortuna ».
Nous n’irons certainement pas jusqu’à comparer le Prince de Machiavel à un DSK ou un Chaouat – rien que d’y penser, cela donne la nausée- mais il est bon de rappeler la portée de notre constitution politique. La République n’est pas un vulgaire libéralisme qui n’exigerait qu’une tenue minimale des femmes ou des hommes politiques. Cette responsabilité est mise en rappel par les citoyennes et citoyens. Sans ces deux bouts déontologiques, les institutions ne sont qu’un leurre alimentant la défiance … ou l’indifférence.
Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Women’s liberation without borders with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest, the author’s permission is required.
Il est essentiel lors de toute utilisation de cette production ou partie de cette production de préciser la source : le lien et l’auteure de l’article, ponctuation adéquate encadrant la citation -entre guillements- et dans son contexte, sans distorsion ni manipulation ( article L122-5, du code de la propriété intellectuelle) . La permission formulée et explicite de l’auteure est également exigée.De la même manière, concepts,termes et approches empruntés à l’auteure du blog doivent être mentionnés comme tels- références adéquates: guillemets, liens, extraits de texte, auteure- avec accord de l’auteure. En vertu du code de la propriété intellectuelle stipulant à l’article L121-1,‘ L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.’